|
|
||
|
À lire:
Pour vous abonner au bulletin électronique de l’auteure, prière d’envoyer un courriel à Écrivez-moi ci-haut, en mettant le mot « bulletin » comme objet. ___________________
|
|
|
|
Profil biographique Révélée au grand public par la saga Les accoucheuses, Anne-Marie Sicotte a une feuille de route jalonnée de romans, d’études historiques sous forme d’albums illustrés et de biographies novatrices (Gratien Gélinas, Marie Gérin-Lajoie et Louis-Joseph Papineau). Passionnée par le Québec d’antan, elle s'est employée à faire revivre l’épopée des insurrections patriotes et du Bas-Canada entre la Conquête et la Confédération. Plus récemment, elle a renoué avec le roman historique en signant Catherine aux cinq maris, qui s’attache à l’étonnante destinée d’une femme de la Nouvelle-France intégrée au sein de la nation iroquoise. Détentrice d’un baccalauréat en histoire et en anthropologie, Anne-Marie Sicotte a pratiqué le métier de journaliste; elle est également directrice des Productions Gratien Gélinas.
Il faut dire que mes parents formaient un couple singulier. Ma mère, Sylvie, était la fille de l’artiste Gratien Gélinas – dont j’ai livré l’existence par écrit – et de son épouse, Simone. Elle a vécu une existence d’une richesse culturelle privilégiée, mais d’un autre côté, malaisée à cause des tensions crées par la personnalité égocentrique de son père. Quant à mon père, Bernard Sicotte, il était issu d’un couple peu instruit. Mon grand-père exerçait le métier de charpentier, et avec son épouse et leur six enfants, il occupait un logement du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Mes parents ont donc travaillé fort pour pour trouver un terrain d’entente entre leurs deux mondes. Tous deux avaient le désir d’échapper à leur milieu, d’élargir leurs horizons. Mais ce pari n’a pas tenu, et à dix ans, mes deux frères et moi étions enfants de divorcés. Ce qui m’a jetée dans un faisceau inextricable de relations humaines tarabiscotées – nouvelle conjointe de mon père, amants de ma mère. J’ai passé tout mon cours secondaire à prétendre, même devant mes meilleures amies, que mon père devait vivre loin à cause de son travail. Mon adolescence fut une époque troublée, que j’évoquerai dans mon roman Les amours fragiles, au bout d’un chantier d’écriture d’une quinzaine d’années. Je m’évadais, entre autres, dans les livres, dans ces existences inventées qui me semblaient tellement plus pertinentes que la mienne. Je ne sais si cette fréquentation assidue des romans jeunesse aurait suffi à éveiller, en moi, le désir d’écrire. Compte davantage, sans doute, le fait que l’écriture était une pratique courante dans mon milieu. Mon grand-père était auteur, et fier de l’être. Sa fille était douée d’une remarquable aisance pour faire sonner la musique des mots. Elle a signé plusieurs recueils de poèmes, entre autres, et quand j’ai lu son journal de création, après sa mort, j’ai été frappée par la manière dont les phrases coulaient de source. Quant à mon père, il a signé de nombreux textes pour la radio et la télévision, avant de se recycler dans l’enseignement. Pour tout dire, il m’était plus facile d’écrire que de parler – surtout que ma grande vitesse d’élocution décourageait mes auditeurs. J’ai pondu mes premiers romans d’aventure à l’âge de dix ans. Hélas, j’ai brûlé toutes ces premières œuvres. C’était une erreur, une errance de l’orgueil. Premier conseil de cette rubrique : confiez vos brouillons à des proches. Aujourd’hui, j’aimerais bien m’amuser – et apprendre – de mes premiers pas. L’époque de mes études universitaires fut beaucoup plus effervescente; j’ai découvert toutes sortes de choses en moi, dont une réserve quasi inépuisable d’indignation devant notre société de consommation à outrance. J’ai garni de mes textes les pages de plusieurs journaux étudiants (Le Sablier, Continuum et Parenthèses) de l’Université de Montréal, où j’ai obtenu en 1984 un baccalauréat en histoire et en anthropologie. Pourquoi l’histoire? C’était sans doute relié à ma quête personnelle : pour comprendre qui j’étais, savoir d’où je venais. Je me suis construite grâce à un retour aux sources de mon existence. Tout naturellement, j’ai cru possible de faire de même pour comprendre les maux de notre monde. Je creuse le parcours de sociétés révolues, prodigues en enseignements de toutes sortes, et j’approfondis la nature humaine en fouillant maintes vies passées, ce qui me fait personnellement grandir. Je suis persuadée d’une chose : le mensonge est nocif. Dans la vie privée autant que publique, distortions de la réalité et contrefaçons de la vérité plongent les personnes concernées dans une désolante spirale de dissimulation. À mon entrée dans le monde professionnel, j’ai poursuivi mes activités journalistiques au sein de plusieurs revues et journaux, en tant que collaboratrice ou rédactrice en chef (Magazine M, Liaison Saint-Louis, La Criée, Vélo Mag). En même temps, j’ai entrepris de partager mes découvertes en science historique, à commencer par deux publications de vulgarisation historique pour le compte du Lieu historique national du Canal de Lachine, à Montréal. À 27 ans, j’ai vécu la maladie, puis la mort de ma mère, ce qui a entraîné chez moi un vif besoin de connaître celle qui gardait son intimité fermée à clé, de donner du sens à son existence, d’expliciter ses choix de vie et de colorer la nature de son amour envers moi, sa fille. J’ai plongé dans ses archives personnelles, un voyage qui m’a fait évoluer comme jamais. La découverte de ses doutes, de ses blessures, de son intense humanité, m’a fait comprendre à quel point un être ne peut donner que ce qu’il a reçu. Ce qui m’a entraîné vers une dernière strate à débrouissailler dans mon histoire personnelle. De « grand-bonbon », Gratien Gélinas devenait un artiste vieillissant que, armée de mon magnétophone, je me suis mise à interroger. Peu à peu, je me suis laissée emporter par le projet stimulant d’écrire la première biographie complète à son sujet. Dans La Ferveur et le Doute, j’ai déroulé le fil de sa vie selon les deux principales lignes de force de son tempérament : celles qui ont fait de lui un créateur fervent et acharné, mais perpétuellement miné par l’insécurité et le doute. Il s’agissait de montrer la vie d’un homme qui inventait une dramaturgie, qui révolutionnait l’imaginaire collectif canadien-français, mais pour qui la quête de reconnaissance a constitué le drame intime de sa vie. La fin du 20e siècle fut donc fertile en naissances, depuis les deux tomes de la biographie de mon grand-père jusqu’à mes trois enfants. Puis, après deux courtes biographies romancées (Gratien Gélinas et Justine Lacoste-Beaubien), j’ai tenté de fusionner à mon amour pour les photographies anciennes, qui suscitent un éveil à la science historique comme peu d’ouvrages savants peuvent le faire, avec mon désir de mettre les richesses et les enseignements du passé à la portée du grand public. Depuis, j’ai engendré trois albums illustrés. Quartiers ouvriers d’autrefois, 1850-1950, raconte en images l’industrialisation des villes de Sherbrooke, Québec et Montréal, passage tumultueux entre l’ancienne société agricole et le monde contemporain. Ensuite, l’idée de Femmes de lumière : Les religieuses québécoises avant la Révolution tranquille m’est venue au cours de mes recherches sur l’histoire de la toute puissante religion catholique au Québec. Il était impossible de nier l’importance passée des religieuses, comme nous avons eu tendance à le faire depuis la fin de la « grande noirceur ». Dans cette veine, j’ai voulu recréer le Québec sous le régime de terreur fondé sur la peur du péché et de l’enfer : c’est ce que dévoile Les années pieuses, 1860-1970. Les années suivantes ont été biographiques. L’une des plus importantes féministes québécoises était honteusement ignorée, notamment parce que le récit de sa vie dormait encore dans les archives : Marie Gérin-Lajoie : Conquérante de la liberté (2005). Mais depuis ma prime jeunesse, l’appel de la fiction murmurait en moi comme le ressac de la marée, surtout depuis qu’une de mes nouvelles s’était mérité en 1992 le grand prix du concours annuel du journal Voir (reprise dans l’ouvrage collectif Circonstances particulières). Ce qui a donné Les amours fragiles (2003), puis un roman jeunesse, Le lutin dans la pomme. Jalons d’un parcours qui tendait vers le roman historique : en catimini, chaque création me donnait des outils supplémentaires pour bien ciseler une histoire dans l’Histoire. J’aspirais à redonner vie à un passé qui s’agite toujours en nous, pour le meilleur et pour le pire, même à notre corps défendant. J’avais tendance à penser que seule la pointe de l’iceberg avait été mise au jour concernant le Québec d’antan. Nos ancêtres étaient diablement moins conformistes qu’on le croit généralement! Au faîte de mon panthéon personnel, je plaçais les « vraies » sagas historiques – car à mon sens, bien des romans situés dans le passé n’en sont pas, car l’Histoire n’y vit guère, formant principalement un panorama pittoresque. Au contraire, il faut recréer un monde dans toute sa luxuriance et dans lequel le lectorat s’immerge, ce qui exige des compétences en recherche, en synthèse et en vulgarisation. Je songe à Jean Auel, James Michener et Ken Follett, à Thyde Monnier, Henri Troyat et Robert Merle… Je suis aussi touchée par le réalisme poétique et sensible, à la manière de John Steinbeck, de Gabrielle Roy, d’Émile Zola, de Charlotte Brontë.
Résultat : Les accoucheuses. Pour faire vivre Flavie, apprentie sage-femme, et sa mère, j’ai puisé dans mes aventures personnelles, par exemple l’expérience de la maternité. En trois tomes, je déroule une âpre lutte entre sages-femmes et hommes de l’art, entre dames patronnesses et curés en soutanes. Un succès de vente, jusqu’en Europe, en a découlé. Je mettais la touche finale au dernier tome de la trilogie des Accoucheuses lorsqu’un personnage s’est présenté à moi. La personnalité de cette femme s’ébauchait clairement, un cheminement émotif et relationnel que moi-même, à une certaine époque, j’ai expérimenté… Une découverte fortuite m’a permis de l’ancrer dans l’époque des patriotes du Bas-Canada : le village de Saint-Denis-sur-Richelieu abritait une imposante communauté d’artisans-potiers. Il se trouve qu’à un certain moment de ma vie, j’ai travaillé assidûment la glaise… Il n’en fallait pas davantage pour me propulser. Rapidement, j’ai compris que notre connaissance de ces quelques décennies capitales de notre histoire était bancale. La fabuleuse aventure des patriotes méritait d’être contée dans une fresque romanesque. Celle-ci se décline en deux cycles : Le pays insoumis (tome 1 : Les chevaliers de la croix et tome 2 : Rue du Sang) et ensuite Les tuques bleues (tome 1 : Le charivari de la liberté et tome 2 : Le règne de la canaille). L’un de mes principaux défis a été de coller au plus près d’une réalité historique qu’il m’a fallu débusquer puisque les historiens du Québec sous la domination britannique ont cru bon de « taire le vrai », comme a dit très justement Louis-Joseph Papineau. Car dans l’historiographie, ce dernier subissait un sort indigne à mes yeux : critiqué, censuré et même calomnié, il méritait selon moi un chantier de rénovation de fond en comble. J’y ai consacré une demi-douzaine d’années supplémentaires, au terme desquelles j’ai fait paraître Papineau – Par amour avant tout (2021), puis les deux tomes (2022-2023) de la monumentale biographie Papineau l’incorruptible (tome 1 : La flamme du patriote, 1786-1832; tome 2 : Le président rebelle, 1833-1871). Stimulée par mon intense désir de vulgarisation historique et ma passion pour l’illustration ancienne, j’ai aussi commis Histoire inédite des Patriotes : Un peuple libre en images (2016), devenu depuis un classique. J’avais croisé l’étonnant destin de Catherine Quevillon, l’arrière-grand-mère de Papineau, captive des Iroquois lorsqu’elle était enfant, puis revenue en Nouvelle-France pour y vivre une longue vie aux côtés de quatre époux successifs. Grâce au roman Catherine aux cinq maris (2025), j’ai fait cheminer cette femme et ses proches sur le fragile équilibre de leur histoire métissée… |
||
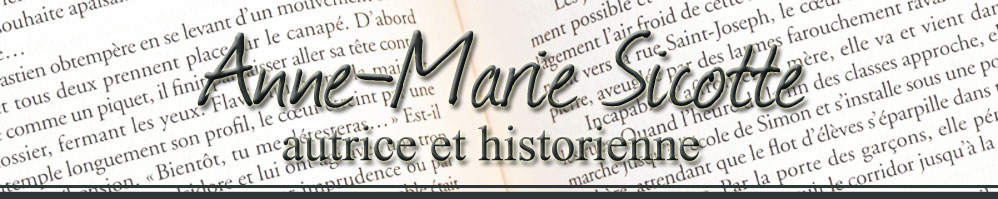
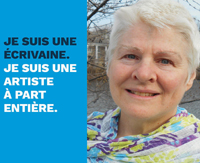
 Je
suis née en 1962, à Montréal. Premier fait remarquable : ma mère m’a
allaitée, contrairement à la majorité des mères de cette époque, qui se
faisaient conseiller par leur médecin de laisser la science engraisser
leur nourrisson. Est-ce à ce désir de réappropriation du processus de la
naissance, alors à ses balbutiements, que je dois mon intérêt marqué
pour cette question? Une chose est sûre : j’ai grandi dans un milieu
non-conformiste, ouvert aux expérimentations.
Je
suis née en 1962, à Montréal. Premier fait remarquable : ma mère m’a
allaitée, contrairement à la majorité des mères de cette époque, qui se
faisaient conseiller par leur médecin de laisser la science engraisser
leur nourrisson. Est-ce à ce désir de réappropriation du processus de la
naissance, alors à ses balbutiements, que je dois mon intérêt marqué
pour cette question? Une chose est sûre : j’ai grandi dans un milieu
non-conformiste, ouvert aux expérimentations. Un
personnage s’est ancré en moi : une femme de tempérament,
professionnellement ambitieuse, mais dont l’ardeur butait sur le mur des
conventions sociales. L’exemple de Marie Gérin-Lajoie m’inspirait, car
j’étais séduite par sa combativité et je me demandais comment elle avait
pu garder espoir malgré les ridicules préjugés sur l’intelligence et la
valeur des femmes. Parallèlement, le débat public faisait rage au Québec
concernant l’intégration des sages-femmes dans le système public de
santé et je vibrais d’indignation devant leur exclusion, selon moi une
flagrante injustice. Depuis longtemps, je remettais en question la
consommation à outrance et la surmédicalisation.
Un
personnage s’est ancré en moi : une femme de tempérament,
professionnellement ambitieuse, mais dont l’ardeur butait sur le mur des
conventions sociales. L’exemple de Marie Gérin-Lajoie m’inspirait, car
j’étais séduite par sa combativité et je me demandais comment elle avait
pu garder espoir malgré les ridicules préjugés sur l’intelligence et la
valeur des femmes. Parallèlement, le débat public faisait rage au Québec
concernant l’intégration des sages-femmes dans le système public de
santé et je vibrais d’indignation devant leur exclusion, selon moi une
flagrante injustice. Depuis longtemps, je remettais en question la
consommation à outrance et la surmédicalisation.